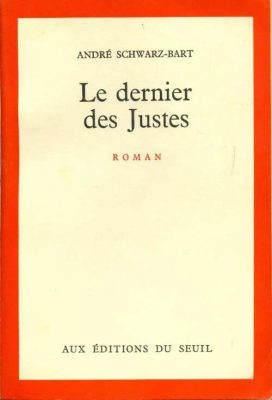Quand Le Dernier des Justes paraît aux éditions du Seuil en 1959, son auteur, André Schwarz-Bart, n’a que trente-et-un ans. Né en 1928 à Metz dans une famille juive polonaise réfugiée en France, il grandit dans une atmosphère mêlée d’exil et de promesse. Son enfance est brisée par la guerre : ses parents et presque tous ses proches sont arrêtés, déportés et assassinés à Auschwitz.
Lui-même, adolescent, survit en se cachant. Trop jeune pour être passé par les camps, trop vieux pour oublier, il porte en lui une douleur impossible à dire d’un ton direct. Pendant des années, il lit, il écoute, il se tait, et cherche une forme qui puisse accueillir la mémoire des disparus. Le Dernier des Justes naît de ce long silence : un roman conçu non comme un témoignage, mais comme un tombeau littéraire, un kaddish écrit en français.
Pour donner forme à cette mémoire, Schwarz-Bart remonte huit siècles en arrière. Le roman suit la lignée des Lévy, Justes successifs issus de la tradition hassidique des Lamed-Vovniks, ces trente-six hommes dont la bonté secrète soutiendrait l’équilibre du monde. On traverse ainsi York en 1185, les pogroms allemands, les errances espagnoles, les shtetls de Pologne.
Lui-même, adolescent, survit en se cachant. Trop jeune pour être passé par les camps, trop vieux pour oublier, il porte en lui une douleur impossible à dire d’un ton direct. Pendant des années, il lit, il écoute, il se tait, et cherche une forme qui puisse accueillir la mémoire des disparus. Le Dernier des Justes naît de ce long silence : un roman conçu non comme un témoignage, mais comme un tombeau littéraire, un kaddish écrit en français.
Pour donner forme à cette mémoire, Schwarz-Bart remonte huit siècles en arrière. Le roman suit la lignée des Lévy, Justes successifs issus de la tradition hassidique des Lamed-Vovniks, ces trente-six hommes dont la bonté secrète soutiendrait l’équilibre du monde. On traverse ainsi York en 1185, les pogroms allemands, les errances espagnoles, les shtetls de Pologne.
Cette longue généalogie relève du mythe, mais s’appuie sur une vérité morale : la persistance d’un peuple ballotté, endurant, blessé, et pourtant habité d’une force douce. Les ancêtres Lévy semblent sortir d’une anthologie yiddish : un tailleur parlant seul dans la neige pour tromper la peur, un rabbin pleurant entre deux plaisanteries adressées à sa femme, un vieil homme répondant aux humiliations par un proverbe biblique un peu tordu comme ceux des mères du shtetl.
Schwarz-Bart écrit en français, mais ses personnages respirent comme des figures de Sholem Aleichem ou d’I.L. Peretz. Il n’imite pas la littérature yiddish : il en retrouve la tendresse ironique, cette lumière qui réchauffe même au cœur du malheur.
La structure généalogique du roman n’est pas un simple procédé. Elle impose au lecteur une descente, siècle après siècle, dans une histoire qui se fait plus sombre, comme si la lignée s’approchait malgré elle d’un gouffre. Mais cette lente chute est ponctuée de clartés : plaisanteries improvisées, dignité obstinée, sagesse du pauvre et humour du malchanceux.
La structure généalogique du roman n’est pas un simple procédé. Elle impose au lecteur une descente, siècle après siècle, dans une histoire qui se fait plus sombre, comme si la lignée s’approchait malgré elle d’un gouffre. Mais cette lente chute est ponctuée de clartés : plaisanteries improvisées, dignité obstinée, sagesse du pauvre et humour du malchanceux.
Schwarz-Bart utilise souvent des tournures qui rappellent la prose orale yiddish : répétitions incantatoires, balancements narratifs, formules de conte. Le français devient ici une langue adoptive où souffle une âme étrangère : une langue yiddish sublimée, sans yiddish.
À la jonction de ce long récit apparaît Ernie Lévy, dernier descendant de la lignée. Enfant maladif, rougissant, moqué, mais d’une bonté illimitée, il incarne un type de héros profondément yiddish : le schlemiel, celui qui chute toujours, mais dont la chute révèle la vérité morale du monde.
À la jonction de ce long récit apparaît Ernie Lévy, dernier descendant de la lignée. Enfant maladif, rougissant, moqué, mais d’une bonté illimitée, il incarne un type de héros profondément yiddish : le schlemiel, celui qui chute toujours, mais dont la chute révèle la vérité morale du monde.
Ernie est un être sans défense, qui éprouve de la compassion même pour ses bourreaux. Un jour où des adolescents allemands le harcèlent, il pense d’abord “à leur tristesse future”, comme si la haine devait être consolée plutôt que rendue.
C’est l’essence même du Juste : une sainteté du quotidien, une bonté sans ostentation, faite de gestes minuscules — ramasser un oiseau blessé, céder sa ration à un enfant, inventer un jeu pour apaiser la peur. Cette figure du tsaddik de la rue, familière dans les contes hassidiques, reparaît ici en pleine Europe fasciste.
La montée du nazisme transforme cette bonté en vulnérabilité absolue. La famille Lévy, puis Ernie seul, glissent vers la persécution, l’exil, les camps français.
La montée du nazisme transforme cette bonté en vulnérabilité absolue. La famille Lévy, puis Ernie seul, glissent vers la persécution, l’exil, les camps français.
À Gurs, l’humour yiddish surgit comme une rébellion morale : un vieux Juif explique que la soupe “n’a même pas assez d’eau pour être honnête”, un autre mime un violon pour se réchauffer, un troisième murmure que “la seule chose gratuite ici est le vent, et encore, il faut le partager”.
Ces répliques ne sont pas des éclats comiques : elles sont une dignité, une façon de donner forme à l’indicible. Le roman entier repose sur cette alchimie : transformer l’horreur en compassion, la souffrance en humour fragile, la mort en mémoire.
La dernière partie du livre, consacrée à la déportation d’Ernie à Auschwitz, est d’une retenue bouleversante. Dans les pages finales, Ernie accompagne un groupe d’enfants vers la chambre à gaz. Il ne peut pas les sauver, mais il peut les consoler : il parle doucement, il invente un conte, il murmure une berceuse.
La dernière partie du livre, consacrée à la déportation d’Ernie à Auschwitz, est d’une retenue bouleversante. Dans les pages finales, Ernie accompagne un groupe d’enfants vers la chambre à gaz. Il ne peut pas les sauver, mais il peut les consoler : il parle doucement, il invente un conte, il murmure une berceuse.
Ce chant improvisé, qui n’emprunte aucun mot au yiddish mais en porte toute la douceur, est le sommet du roman. Dans la tradition juive d’Europe orientale, la dernière chanson, au seuil de la mort, peut être un passage et une protection.
Schwarz-Bart transpose cette idée avec une pudeur déchirante. Le Juste meurt comme il a vécu : en donnant aux autres un peu de paix.
Quand le livre paraît en 1959, il suscite un véritable choc littéraire.
Quand le livre paraît en 1959, il suscite un véritable choc littéraire.
La gauche progressiste et existentialiste reconnaît immédiatement un texte majeur. Dans France-Observateur, Maurice Clavel loue un “chef-d’œuvre d’humanité”, un roman qui s’inscrit dans le combat antiraciste de l’après-guerre.
Autour de Sartre, dans Les Temps Modernes, l’admiration est vive : Beauvoir, Lanzmann ou Jeanson perçoivent une œuvre d’une justesse morale rare.
Le monde catholique de gauche, en particulier la revue Esprit, admire aussi le roman : Albert Memmi souligne sa beauté et sa nécessité, tout en notant une distance inévitable entre l’auteur et le monde yiddish disparu — une critique subtile, qui sera reprise par certains intellectuels yiddishistes.
Du côté du PCF, les réactions sont plus contrastées mais globalement favorables. L’Humanité salue une grande œuvre antifasciste, tout en regrettant un ton jugé trop “mystique” pour une lecture marxiste. Aragon, dans Les Lettres Françaises, est au contraire enthousiaste : il voit dans Schwarz-Bart un grand poète tragique, un créateur d’un mythe moderne.
La droite modérée accueille le roman avec respect, mais la presse d’extrême droite déchaîne une hostilité flagrante : Rivarol ou Aspects de la France accusent l’auteur d’“exploiter la souffrance juive” ou de “culpabiliser l’Europe”. Ces attaques, teintées d’antisémitisme, blessent profondément Schwarz-Bart, qui se retire presque totalement de la vie littéraire après le succès.
Dans le milieu yiddish parisien, l’accueil est chaleureux mais nuancé : plusieurs chroniqueurs du Undzer Vort admirent la tendresse du livre, mais regrettent parfois que Schwarz-Bart décrive un monde qu’il n’a pas vécu de l’intérieur. Non par rejet, mais parce que pour beaucoup d’écrivains yiddish, le shtetl n’était pas un mythe : c’était leur enfance perdue.
L’étranger, enfin, applaudit sans réserve : aux États-Unis, la New York Times Book Review parle d’un roman d’une “universalité déchirante”, et l’Allemagne, encore en pleine introspection, accueille le livre avec humilité et respect.
Le 17 novembre 1959, Le Dernier des Justes reçoit le prix Goncourt, couronnant un triomphe littéraire sans précédent pour un premier roman. Plus de soixante ans plus tard, il demeure un livre unique : ni témoignage, ni chronique, ni légende — mais tout cela à la fois. Un roman français écrit avec une âme yiddish ; un monument de compassion ; un tombeau pour des morts sans sépulture ; l’un des textes les plus justes, les plus douloureux, et les plus nécessaires du XXᵉ siècle.
Du côté du PCF, les réactions sont plus contrastées mais globalement favorables. L’Humanité salue une grande œuvre antifasciste, tout en regrettant un ton jugé trop “mystique” pour une lecture marxiste. Aragon, dans Les Lettres Françaises, est au contraire enthousiaste : il voit dans Schwarz-Bart un grand poète tragique, un créateur d’un mythe moderne.
La droite modérée accueille le roman avec respect, mais la presse d’extrême droite déchaîne une hostilité flagrante : Rivarol ou Aspects de la France accusent l’auteur d’“exploiter la souffrance juive” ou de “culpabiliser l’Europe”. Ces attaques, teintées d’antisémitisme, blessent profondément Schwarz-Bart, qui se retire presque totalement de la vie littéraire après le succès.
Dans le milieu yiddish parisien, l’accueil est chaleureux mais nuancé : plusieurs chroniqueurs du Undzer Vort admirent la tendresse du livre, mais regrettent parfois que Schwarz-Bart décrive un monde qu’il n’a pas vécu de l’intérieur. Non par rejet, mais parce que pour beaucoup d’écrivains yiddish, le shtetl n’était pas un mythe : c’était leur enfance perdue.
L’étranger, enfin, applaudit sans réserve : aux États-Unis, la New York Times Book Review parle d’un roman d’une “universalité déchirante”, et l’Allemagne, encore en pleine introspection, accueille le livre avec humilité et respect.
Le 17 novembre 1959, Le Dernier des Justes reçoit le prix Goncourt, couronnant un triomphe littéraire sans précédent pour un premier roman. Plus de soixante ans plus tard, il demeure un livre unique : ni témoignage, ni chronique, ni légende — mais tout cela à la fois. Un roman français écrit avec une âme yiddish ; un monument de compassion ; un tombeau pour des morts sans sépulture ; l’un des textes les plus justes, les plus douloureux, et les plus nécessaires du XXᵉ siècle.